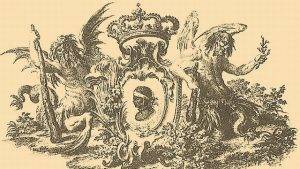Alain Viala*, historien et sociologue de la littérature française définit le « classique » littéraire comme « un auteur toujours déjà lu, une oeuvre précédée d’un commentaire qui en oriente la lecture. Un classique est un écrit dont, qu’on le lise ou non, on a forcément entendu parler. » Un classique est ainsi un livre dont la qualité est reconnue officiellement et que l’on peut lire avec confiance. Ainsi ce qui fait d’un livre un classique c’est qu’il a été lu, approuvé et commenté, et donc légitimé, en tant que classique. En fait, sa valeur a été reconnue à la fois par un grand nombre mais aussi, et c’est la différence avec ce qu’on appelle vulgairement le « roman de gare » (j’y reviendrai car là se joue une différence de classes sociales intéressantes), par des savants, des experts … Bref, par des gens plus qualifiés que vous et moi. C’est la différence entre un Classique et un roman préféré : chaque lecteur à ses classiques, selon ses goûts, son éducation … Pour moi ce sera par exemple Antigone d’Anouilh, Martin Eden* de Jack London, Orgueil et Préjugés de Jane Austen, Des souris et des hommes de Steinbeck, L’attrape-coeurs de J.D Salinger, Bonjour Tristesse de Sagan, Alcools d’Apollinaire, Une saison en Enfer de Rimbaud … (liste non exhaustive) Ce sont mes livres préférés alors j’estime forcément qu’ils méritent d’être lus par tous. Mais au classement des Classiques, des grand titres de la Littérature, un jury d’académiciens les reconnaîtrait-il comme tels ?
En fait, le problème des classiques de la Littérature est le même que le problème des classiques du Cinéma : l’accès.
Pendant mon Master à SciencesPo, notre promo avait été invitée à créer un plan de mécénat pour un cinéma d’art et essais. La directrice et le directeur, au demeurant extrêmement sympathiques, nous avaient un peu reproché, en tant que représentants de la jeunesse actuelle, la faible fréquentation de ce genre de salles par les jeunes. Hors, en nous accusant, ils se trompaient sur 2 plans.
Premièrement, nous ne sommes pas représentatifs de la jeunesse actuelle. Parce-que nous sommes étudiants de SciencesPo, parce-que ce SciencesPo se trouve dans une ville de « province », parce-que cette ville est une ville bourgeoise, parce-que nous sommes en spécialité Culture et Mécénat, et pour plein d’autres raisons, nous ne représentons qu’une tranche de la population des 18-25 ans, et pas un panel représentatif (d’ailleurs, un panel est-il jamais vraiment représentatif ?). Deuxièmement, comme nous l’avions fait remarquer à l’époque, les temps ont changé. Oui, les salles de cinéma art et essais sont peu fréquentées par les jeunes. Mais il y a des raisons à cela. D’abord, la vie coûte cher et pour une place de cinéma on peut se payer plein d’autres choses. Certains préfèrent donc faire autre chose qu’aller au cinéma. D’autre part, les usages ont changé. Aujourd’hui, soit gratuitement soit pour une somme mensuelle assez réduite, on a accès où on veut, quand on veut, autant de fois qu’on veut, à un catalogue cinéma (musical aussi) extrêmement riche. Un abonnement mensuel à Netflix équivaut environ à deux places de cinéma dans n’importe quelle ville (hors réductions, prix festivals, etc). Alors financièrement le choix est vite fait pour certains. D’autre part on est habitués, dans notre génération, à l’immédiateté, et on a une capacité de concentration très faible. Autant dire qu’Autant en emporte le vent n’est pas le film le plus regardé par notre génération. Il y a aussi la question de la com et du marketing : les films d’auteur, il faut les vouloir, il faut les chercher, dans des magazines et chroniques spécialisé.e.s ou sur des plateformes dédiées (ex mubi). Notons aussi qu’avant, on n’allait pas voir un film au cinéma. On allait voir un film qui était précédé d’autres films, courts-métrages, etc. Et puis le catalogue était moins développé. Alors parfois, il n’y avait rien d’autre à faire que se taper des films d’auteurs pas très fun.
Enfin, comme pour la Littérature, il y a avec le cinéma art et essai/d’auteur (même différence pour moi entre « cinéma d’auteur » et cinéma et entre « roman et roman de gare » et roman : une forme de snobisme) une question de sociologie. En fait, c’est une question de capital culturel (qui met à terre la philosophie chère à nos politiques du « quand on veut on peut. » C’est faux : quand on est pauvre et illettré, même quand on veut, on ne peut pas toujours, ou en tous cas pas sans aide, et là encore c’est rare que l’aide tombe du ciel). Si vous n’êtes pas habitué à la faire, si vous n’avez pas été éduqué à le faire, poussé à le faire (par vos proches, par vos profs …), il y a peu de chance que vous vous réveilliez un matin en vous disant « Marre des comédies américaines potaches, je vais plutôt me faire l’intégrale de Dario Argento, Luis Bunuel, Kenji Mizoguchi ou Pier Paolo Pasolini ! »

Un problème de capital culturel
Pierre Bourdieu (sociologue, 1930-2002) a conceptualisé une forme de capital qui n’est pas financière ou matérielle : le capital culturel. A noter : selon Bourdieu, le capital représente les avantages hérités de son environnement social et familial. Le sociologue précise que le capital est rarement acquis mais souvent attribué. C’est-à-dire qu’il est souvent un héritage. Contrairement à Sartre, dont nous avons déjà parlé, pour Bourdieu l’être humain est déterminé, pas biologiquement mais sociologiquement.
Il distingue quatre formes de capital :
- le capital économique (revenus, patrimoine, biens matériels, moyens de production …), qui favorise la domination d’une classe sur une autre
- le capital social, ou la structure du réseau d’un individu et le degré d’utilité de ces relations, en termes de nombre et d’importance (en quelque sorte l’utilité potentielle de ces personnes)
- le capital symbolique, qui donne de la valeur sociale à un individu
- et enfin, celui nous intéresse ici : le capital culturel. Celui-ci est composé de tout ce qui permet à un individu d’avoir des clés pour se représenter le monde, comprendre, penser et agir. Le capital culturel est présent à la fois dans le rapport à la Culture (la manière d’appréhender d’une exposition d’art contemporain, d’un film, d’une musique …) et dans la manière d’être (la question du comportement social, du goût, de la façon de vivre …)
Ces capitaux assoient une relation de domination de certains sur d’autres. Il est évident que lorsque le capital d’une personne est élevé, il a l’avantage sur une personne dont les capitaux sont faibles. De plus, ces capitaux sont liés les uns aux autres. Ainsi, avec un capital économique élevé vient souvent un capital social et un capital symbolique importants. Cela dit, il est important de noter qu’un capital économique élevé n’implique pas forcément un capital culturel élevé et inversement. Et un capital culturel important, s’il n’est pas forcément lié à un capital économique important, peut apporter un capital social et un capital symbolique importants.
Donc voilà le problème : même riche (capital économique), si on a pas le capital culturel suffisant, on ne va pas fréquenter les « classiques » du cinéma, et encore moins les « films d’auteurs », car comme la Littérature, ceux-ci nécessitent une somme de connaissances symboliques, en fait des clés, qui ne sont accessibles que par une éducation qu’il n’est pas impossible mais difficile de commencer soi-même. Si vos parents n’ont pas de bibliothèque chez eux, il y a fort à parier que vous lirez peu ou pas. De la même manière, si vous parents n’ont pas d’abonnement à des chaînes cinéma ou de bibliothèque de DVD de films d’auteurs, vous n’en regarderez pas de votre propre chef. Evidemment, ce n’est pas irrémédiable. Vous pouvez toujours développer l’envie de cultiver vos connaissances en Littérature et Cinéma sur l’impulsion d’amis (même si on fréquente souvent des gens qui ont les mêmes capitaux que nous …), de professeurs … ou avoir un déclic au détour d’une librairie, d’un cinéma, d’un post Twitter … Ainsi, les « classiques » impliquent d’avoir au départ au moins un capital culturel élevé, qui est hérité, et qu’on va continuer à développer au fil de nos lectures, visionnages, visites d’expositions, etc. En fait, pour Bourdieu, si le capital économique est hérité, le capital culturel ne l’est pas directement. Il demande du temps et des efforts, du moins en partie (en partie car il découle aussi d’un milieu dans lequel on baigne, cependant la transmission culturelle n’est pas forcément automatique)*
Ce qui est intéressant chez Bourdieu c’est qu’il ne pense pas en termes marxistes de prolétaires/bourgeois mais de dominés/dominants, ce qui permet vision plus nuancée des choses : la domination d’une classe sur une autre ne s’exerce pas seulement en fonction des moyens de production possédés par la classe dominante mais par tout un système, qui repose sur différents capitaux.
Le rôle de l’éducation : contre la méritocratie
La cécité aux inégalités sociales condamne et autorise à expliquer toutes les inégalités, particulièrement en matière de réussite scolaire, comme inégalités naturelles, inégalités de dons.
Pierre Bourdieu, Les Héritiers, 1964
Dans la pensée de Bourdieu, l’école est importante. Tout d’abord, pour son collègue Jean-Claude Passeron et lui (co-auteur de Les Héritiers, 1964), l’école est vectrice d’inégalités car, par les codes sociaux et linguistiques qu’elle exige, elle favorise les classes dominantes, exerçant ainsi une violence symbolique sur les élèves. Pour les deux sociologues l’école creuse ainsi les écarts de classe plus qu’elle ne les gomme et favorise la reproduction sociale. En fait, l’école sélectionnerait ce qui est culturellement légitime et renforcerait ainsi la position dominante des classes déjà dominantes en excluant les classes dominées.
Un autre concept intéressant développé par Bourdieu et Passeron est la notion de violence symbolique, qui désigne une violence « dont l’effectivité est liée à sa méconnaissance » (Wikipédia). C’est un processus d’intériorisation par une personne de la domination sociale inhérente à la position, généralement sociale, qu’elle occupe. C’est une violence structurale, c’est-à-dire par d’un individu sur un autre.
Dans La Reproduction (1970), Bourdieu et Passeron montrent que le système d’enseignement français exerce un pouvoir de violence symbolique qui contribue à légitimer le rapport de force à l’origine des hiérarchies sociales. En effet, pour les deux auteurs, le système éducatif transmet des savoirs qui sont proches de ceux de la classe dominante. Les enfants de la classe dominante disposent ainsi d’un capital culturel qui leur donne un avantage sur ceux de la ou des classes dominée.s. Ainsi ils réussissent mieux leurs études et perpétuent la reproduction sociale. D’autre part, pour Bourdieu, ce sytème est entretenu par la croyance que l’école est neutre, donc détachée des questions de classes sociales, et que la réussite scolaire dépend des individus (c’est le fameux « quand on veut on peut », autrement appelé « méritocratie »).
la méritocratie consiste à penser que « quand on veut on peut » et qu’on obtient dans la vie ce que l’on mérite. Donc si on travaille bien et dur et qu’on est moralement bon par exemple on va réussir dans la vie (je parle ici de réussite sociale, c’est-à-dire de l’idée de la réussite que nous présente la société) et que ce sera mérité. En quelque sorte, il s’agira d’un juste retour des choses, d’un salaire. Hors c’est oublier que les individus ne sont pas qu’individualité et qu’ils sont aussi déterminés par des facteurs sociologiques qui vont soit leur faciliter l’accès à cette réussite soit la leur compliquer. C’est une façon de penser nocive parce-qu’elle légitime l’existence d’écarts entre les classes alors que ces écarts ne sont ni biologiques (la classe dominante n’est pas composée des plus musclés ou des plus rapides) ni irrémédiables. Cela renforce, de plus, la violence subie par l’individu, qui tend à attribuer son échec à ses propres faiblesses.
La philosophie de Bourdieu peut sembler fataliste alors qu’elle ne l’est pas. Certes Bourdieu conceptualise l’existence de déterminismes non pas biologiques mais sociologiques, difficiles mais pas impossibles à surmonter : en enquêtant, en théorisant et en pointant du doigt, la sociologie, pour Bourdieu, doit permettre l’action, et donc le changement – pour le meilleur, on l’espère.
La sociologie ne conduit pas au fatalisme du tout, elle donne des armes pour une action rationnelle sur le monde social, […] elle donne plus de chances d’agir avec une prévision raisonnable des conséquences de ce qu’on fait… et avec moins de chances, par conséquent, d’être récupéré par le système.
Pierre Bourdieu, France Culture, 26/09/1977

Une forme de snobisme
On peut remettre en doute l’existence de classes sociales. Pour moi, ces différences existent toujours mais elles ont évolué. Et elles sont perceptibles dans des exemples concrets et pleins de sens que l’on peut facilement observer. On prend souvent l’exemple de l’art contemporain, dont Bourdieu a aussi parlé, qui est souvent très élitiste car il nécessite nombre de clés que l’on ne peut avoir sans une éducation spécifique non pas même à l’Art en général mais à l’Art contemporain et à ses différents courants. Mais plus concrètement, j’aimerais développer deux exemples en lien avec le sujet de cet article.
Premier exemple : le cinéma « d’auteur ». Rien que le terme « auteur » nous met la puce à l’oreille. Quel cinéma n’est pas « d’auteur » ? D’un point de vue pratique, il y toujours un auteur (ou une autrice). Ce cinéma est défini comme suit par Wikipédia : « Le film d’auteur est une expression utilisée pour qualifier l’ensemble des films d’un réalisateur ou un scénariste reflétant sa personnalité artistique. Ce terme cherche avant tout à lier l’œuvre d’un cinéaste à des thèmes de prédilection et la cohérence d’un style novateur et singulier. Il s’agit cependant d’une notion subjective dont il n’existe pas de définition rigoureuse. Le cinéma d’auteur est fréquemment assimilé au cinéma d' »Art et Essai » ou de recherche. » L’article souligne que ce terme s’est développé à partir des années 50/60 avec les cinéastes de la Nouvelle Vague, qui cherchent à faire un cinéma en contradiction avec les normes académiques en vigueur. Pour définir un « film d’auteur », on va y chercher la patte du scénariste ou réalisateur, qui développe son univers et sa vision propres et doit avoir le « final cut » sur son oeuvre. Dans un sens courant, on oppose généralement le cinéma d’auteur au cinéma « commercial ». Et cela prend parfois un caractère négatif, dans un sens ou dans l’autre. Ainsi, dans un épisode de la série Dix pour cent, une réalisatrice dit du cinéma d’auteur qu’il « en faut pour faire plaisir aux professeurs à la retraite ». Mais le cinéma d’auteur est-il simplement celui que l’on trouve dans les cinéma d’Art et essai ou, plus obscur encore, dans les expositions d’Art contemporain ? La frontière est mince entre le cinéma « commercial » et le cinéma « d’auteur ». D’une part il est difficile d’imaginer un cinéma qui ne serait pas commercial car il faut bien financer un film (et un film, cela coûte très cher) et d’autre part, bien des cinéastes ont réussi à associer à la fois la réussite commerciale et un univers ou un propos propres, originaux et anti-académiques. Cela dit, les Tuche font plus d’entrée que les Akerman …
Deuxième exemple : le roman de gare. A quoi pense-t-on quand on pense à un roman de gare ? Fatalement à une femme d’âge moyen (pas assez jeune pour qu’on lui pardonne son goût peu subtil mais pas assez vieille pour qu’on mette ses lectures sur le compte de la sénilité : elle est donc absolument coupable, sans circonstance atténuante, de sa lecture de piètre qualité), dans un train (ou attendant un train), absorbée dans la lecture d’un livre de format un peu plus grand que le livre de poche classique, avec une couverture bariolée ou au contraire entièrement beige avec un gros lettrage, et un titre évocateur tel que « Un automne à Milwaukee ». Le roman de gare, c’est un peu l’arrière-petit-fils du mélodrame : un divertissement facile, qui ne demande ni une grande concentration ni une culture générale d’académicien.ne, et qui ne suscite pas une réflexion profonde. Voilà un genre littéraire absolument méprisé par les intellectuels. Pire que son caractère superficiel, le roman de gare est, dans l’imaginaire collectif, forcément associé à un lectorat féminin (le roman de gare parle souvent d’amour, notons-le). Et on sait bien quelle opinion de la lecture féminine on a longtemps eue et que les préjugés ont la vie dure. Ce genre est devenu carrément une insulte : lorsqu’on veut rabaisser un auteur ou un ouvrage, on le range dans la Littérature de gare. Hors, séparer les romans de gare de la « grande » Littérature (les fameux « classiques » dont je vous parlais tout à l’heure ou les livres qui élèvent l’âme comme les ouvrages de Philosophie), c’est rabaisser tout un lectorat méprisé parce-qu’il a envie de se détendre et de prendre du plaisir plutôt que de se cultiver et de se torturer les méninges en questions existentielles. Et là aussi, c’est asseoir la domination d’une classe (voire d’un sexe) sur une autre.

Donc plutôt que d’accuser les jeunes de se désintéresser du cinéma, prenons la voie de la sociologie et accusons la société. C’est beaucoup moins simple certes mais beaucoup moins réducteur aussi et beaucoup plus utile.
* Dans « Pourquoi est-ce plus difficile de devenir un classique quand on est une femme ? », Alisonne Sinard, France Culture, 17/11/2017. URL : https://www.franceculture.fr/litterature/pourquoi-est-ce-plus-difficile-devenir-un-classique-quand-est-une-femme
* Voir mon article « Martin Eden » du 03/12/2019
* Voir mon article « Faut-il écrire des lettres d’amour pour entrer dans la Pléiade ? » du 24/09/2019
* Voir Draelants Hugues, « Le mérite n’existe pas. Critique d’une vulgate sociologique », Le Débat, vol. 202, no. 5, 2018, pp. 176-183. URL : https://www.cairn-int.info/revue-le-debat-2018-5-page-176.htm
Liens utiles : http://www.slate.fr/story/134963/pourquoi-eleves-reussissent-pas-ecole https://www.franceculture.fr/dossiers/pierre-bourdieu-l-integrale-en-cinq-entretiens-1988 https://www.rse-magazine.com/Pierre-Bourdieu-et-les-formes-de-Capital_a3583.html